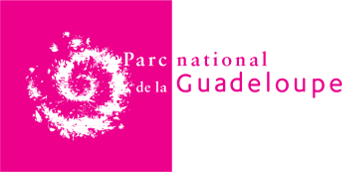La tige de bambou est creuse bien que cloisonnée horizontalement par des nœuds espacés de manière régulière. Ces nœuds abritent les bourgeons qui donnent les branches en forme de touffes denses pouvant atteindre jusqu’à 30 m de haut.
Feuilles : Les feuilles, vertes à jaune également, mesurent jusqu’à 30 cm de long. Elles sont lancéolées (forme de fer de lance), alternes (disposées alternativement de part et d’autre de l’axe de la tige) et glabres (dépourvues de poils) bien qu’on puisse y trouver de petits poils urticants à leur base. Elles présentent des nervures longitudinales parallèles et sont protégées par une gaine.
Fleurs : La floraison est très rare. Lorsque ce phénomène se produit, sur certaines touffes seulement, les fleurs sont groupées en épillets.
Fruits : Le bambou ne produit pas de fruit.
Biologie
Originaire d’Asie du Sud, le bambou commun a été introduit volontairement aux Antilles en 1747. Il est aujourd’hui naturalisé aux Antilles : il s’est adapté à de nombreux environnements tropicaux, en particulier les zones humides comme les berges de rivières. Cette plante colonise rapidement les milieux grâce à sa croissance rapide, son faible taux de mortalité, sa tolérance aux petites inondations et sa reproduction assurée par ses rhizomes souterrains ou par bouturage des tiges. L’espèce a un cycle de vie de 20 à 40 ans (Foch, 2017), avec une floraison unique qui conduit généralement à la mort de la tige.
Chez cette espèce le cycle de floraison est estimé à tous les 80 à 150 ans (Koshy & Pushpangadan, 1997 ; Janzen, 1976).
Menace
Le bambou commun est classé comme espèce exotique envahissante en Guadeloupe. Il s’est fortement et rapidement répandu, le long des routes, des rivières ou sur des terrains en pente, due à son mode de reproduction asexué très efficace : sur une canne de bambou, chaque nœud présente plusieurs bourgeons qui peuvent tous donner une nouvelle pousse lorsqu’ils atteignent le sol. Ses graines se dispersent très facilement, notamment par l’action du vent et de l’eau, surtout si la plante se trouve en bord de rivière. De ce fait, le bambou colonise de nouveaux espaces très rapidement et forme des massifs denses qui empêchent la végétation locale de se développer. De plus, il ne fait pas partie de la chaîne alimentaire locale, c’est-à-dire qu’il n’a pas de prédateur sur l’île, son bois se décompose difficilement dans le sol à cause de sa forte teneur en silice et ses racines, qui s’étendent horizontalement dans les premiers centimètres sous terre, peuvent déstabiliser le sol, ce qui peut provoquer de l’érosion ou même des glissements de terrain.
Gestion
L’élimination d’un massif de bambou peut être complexe : jusqu’à 3 à 5 fois plus de moyens humains et financiers sont nécessaires par rapport à un arbre. Des suivis précis sont menés pour préserver la biodiversité locale ainsi que l’intervention de professionnels spécialisés pour atteindre les touffes parfois situées dans des zones difficiles d’accès.
Aux Antilles, les tiges du bambou commun sont utilisées depuis des générations pour fabriquer des meubles, des instruments de musique, ou encore les canots à voile traditionnelle de Guadeloupe.
Le PNG en action
Le Parc national de la Guadeloupe travaille à trouver des méthodes efficaces de lutte contre la prolifération de l’espèce. Des actions de régularisation sont menées en cœur de parc national dans le cadre du projet Providence. Une fiche technique est également en cours de validation par l’UICN et sera bientôt disponible pour l’ensemble des personnes qui souhaitent en venir a bout pour planter des espèces locales !
Rédaction : Florine Aune, mai 2025
Sources :
J. Portecop. (2011). A la découverte des arbres introduits des Antilles. Tome 3. PLB Editions
Bambusa vulgaris. (s. d.). Espèces Envahissantes Outre-mer. https://especes-envahissantes-outremer.fr/especes_envahissante/bambusa-vulgaris-2/
Foch, T., (2017). Bambou commun. Bambusa vulgaris. Fiche espèce réalisée dans le cadre des travaux du groupe de travail Invasions Biologiques en milieux aquatiques – Agence française pour la biodiversité & UICN France.
UICN Comité français, MNHN & CBIG (2019). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de Guadeloupe. Paris, France.
Sarat, E., Foch, T., Gayot, M.,Van Laere, G. (2017). Bambou commun. Chantier expérimental de régulation du Bambou dans le cœur du Parc national de la Guadeloupe. Retour d’expérience de gestion réalisé dans le cadre des travaux du groupe de travail Invasions Biologiques en milieux aquatiques – Agence française pour la biodiversité & UICN France.
Kalanzi, F., Kiyingi, I., Mwanja, C. K., Agaba, H., Malinga, M., Reza, S. & Jayaraman, D. (2024). Morphological Characteristics and Growth Performance of Bambusa vulgaris Schrad. Ex J. C. Wendl in Selected Agro-Ecologies of Uganda East African Journal of Forestry and Agroforestry, 7(1), 76-86. https://doi.org/10.37284/eajfa.7.1.1802
Met, P. (2025) La physiologie du bambou (s. d.). https://www.le-chatel-des-vivaces.com/content/24-la-physiologie-du-bambou
Koshy, K. C., & Pushpangadan, P. (1997). Bambusa vulgaris blooms, a leap towards extinction? Current Science, 72(9), 622–624. http://www.jstor.org/stable/24099667
Janzen, D. H. (1976). Why bamboos wait so long to flower. Annu. Rev. Ecol. Syst. 7, 347–391. doi: 10.2307/2096871